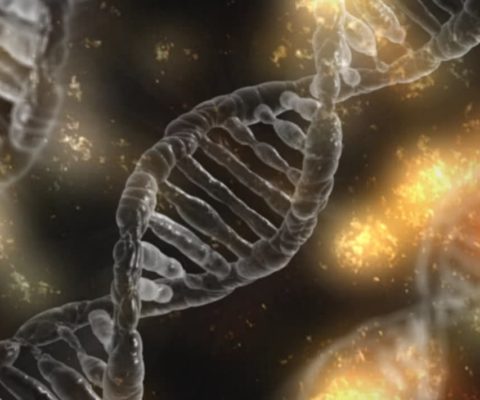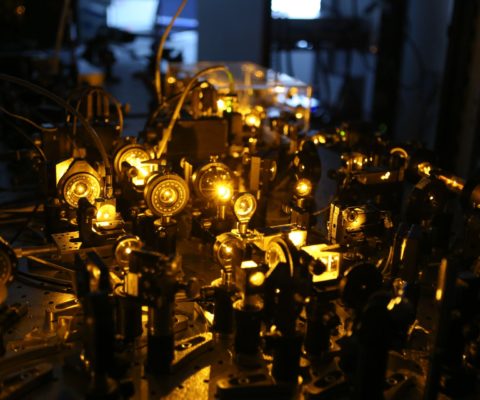L’illusion dangereuse de l’égalité devant l’épidémie
Pr Didier Fassin
L’idée commune selon laquelle le coronavirus nous affecte toutes et tous sans faire de différences, hommes et femmes, jeunes et vieux, urbains et ruraux, cadres et ouvriers, riches et pauvres, est certainement utile pour susciter l’adhésion de l’ensemble de la société aux nécessaires mesures de prévention, et l’on peut comprendre, jusqu’à un certain point, que les responsables politiques l’expriment. Mais elle est profondément fausse, et c’est même une illusion dangereuse, car elle mène à la cécité et à l’inertie là où la lucidité et l’action devraient prévaloir. L’invoquer peut donc sembler de bonne tactique, mais c’est une mauvaise stratégie.
Que les épidémies frappent de façon inégale les membres des sociétés où elles sévissent est d’ailleurs un fait bien connu. Les historiens l’ont montré pour le choléra de 1830 en Europe, les épidémiologistes l’ont établi pour la grippe espagnole en 1918 à Chicago et pour le sida au début des années 2000 en Afrique du Sud, et je l’avais constaté à propos de la rougeole et de la variole en étudiant des registres paroissiaux du dix-neuvième siècle en Équateur. S’agissant du Covid-19, peu de pays ont, jusqu’à présent, fourni des données.
Les premières analyses faites aux États-Unis montrent toutefois que, dans le Michigan et l’Illinois, le risque pour les Afro-Américains d’être infectés est deux fois plus élevé que ne le laisserait supposer leur poids démographique dans la population générale, et que ce ratio est même de trois pour le risque de mourir. En Louisiane, où les Afro-Américains représentent le tiers des résidents, ils comptent pour plus des deux tiers des décès. Dans la ville de New York, leur taux ajusté de mortalité est le double de celui des Blancs. Les explications avancées de cette surmorbidité et de cette surmortalité sont multiples : les membres des minorités noires occupent pour la plupart des emplois pour lesquels ils n’ont pas le choix de rester chez eux ; ils vivent souvent dans des quartiers pauvres et des logements sociaux où les contacts sont moins évitables ; ils se voient plus rarement proposer un test de dépistage lorsqu’ils présentent de la toux et de la fièvre ; s’ils sont malades, ils présentent plus fréquemment des facteurs de gravité tels que diabète, asthme ou cardiopathie ; enfin, si une hospitalisation s’impose, l’accès à des soins de réanimation s’avère difficile quand ils n’ont pas de couverture médicale. Mais le coronavirus ne fait que révéler un fait plus général aux États-Unis, à savoir l’excès de maladies et de décès parmi les Noirs, dont l’espérance de vie à la naissance peut être jusqu’à quinze ans plus brève que celle des Blancs. La France n’a pas diffusé de données incluant des indicateurs de différenciation sociale, mais tout conduit à penser que les mêmes causes y produiront les mêmes effets, ce que les statistiques de décès en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine avec la plus forte concentration de minorités ethnoraciales, laissent déjà entrevoir.
On a, jusqu’à présent, beaucoup insisté sur les disparités de survie des personnes infectées en fonction de leur âge, avec une létalité de la maladie très supérieure au-delà de soixante-quinze ans, et en fonction de leur état de santé, en particulier de l’existence de pathologies préexistantes. On peut parler dans ce cas de vulnérabilité, car il n’est guère possible d’agir sur ces facteurs à ce stade, même si l’on sait que le vieillissement et plusieurs de ces pathologies préexistantes ont une forte détermination sociale. Mais il y a deux autres situations sur lesquelles il est possible et urgent d’intervenir.
La première disparité concerne les milieux socialement défavorisés dont les types de logement et les conditions de travail rendent malaisé le respect des consignes de prévention, dont l’accès au dépistage s’avère souvent plus difficile et qui doivent plus fréquemment renoncer à des soins. Cette disparité touche surtout les quartiers populaires, les grands ensembles d’habitat social et les campements plus ou moins licites des gens du voyage. Il s’agit d’inégalités auxquelles s’ajoute une double injustice : en se contentant d’incriminer leur comportement, on leur impute le risque plus élevé auquel ils sont exposés, phénomène bien connu consistant à blâmer les victimes ; et dans le cadre de l’état d’urgence, on les soumet à des mesures de contrôle plus répressives que ce n’est le cas pour le reste de la population.
La seconde disparité affecte trois catégories de population que la société, à travers les politiques de ses gouvernants, expose délibérément au risque infectieux en les confinant dans des conditions qui rendent impossible la prévention qu’elle promeut par ailleurs. D’abord, les prisonniers en maison d’arrêt, dont 44% sont en détention préventive, par conséquent en attente d’un jugement, et dont 27% sont condamnés à moins d’un an d’emprisonnement, donc souvent pour des délits mineurs, sont depuis des années en surnombre croissant, avec presque partout un enfermement à deux ou trois dans des cellules prévues pour une personne. La libération bienvenue de plusieurs milliers de détenus n’a pas compensé le fait que la survenue de nombreux cas et, par conséquent, l’isolement des contacts a encore accru la surpopulation dans le reste des cellules, rendant les conditions de détention intenables pour les prisonniers comme pour les surveillants. Ensuite, les étrangers internés dans les centres de rétention administrative à cause de leur situation irrégulière et en attente de leur éloignement se trouvent dans une situation aussi dangereuse qu’absurde, puisqu’il n’y a plus de vols pour les reconduire dans leur pays. Les juges en ont remis un certain nombre en liberté, mais les autres en sont réduits à des grèves de la faim et des automutilations pour tenter d’attirer l’attention du public sur l’insalubrité et le danger des lieux dans lesquels ils sont retenus. Enfin, les demandeurs d’asile à la rue et les personnes sans domicile ont été, pour beaucoup, regroupés par centaines dans des gymnases et divers lieux où ils sont contraints à des promiscuités alarmantes. Quant aux autres, plus précaires encore, ils survivent dans des espaces publics où tout espoir de prévention est vain. Dans ces trois cas, on a affaire à des discriminations, au sens strict de traitements défavorables reposant sur un critère illégitime, car ni la commission d’un délit, ni l’absence de titre de séjour, ni la grande pauvreté ne peut justifier de soumettre sciemment des personnes au risque d’une maladie mortelle.
Vulnérabilité, inégalité, discrimination. Trois concepts pour différencier les types de disparité face au Covid-19. Il existe des recoupements entre les trois, mais l’intérêt de ce triptyque est d’inviter à penser des formes distinctes de responsabilité collective à l’égard de ces situations et, par conséquent, des actions visant à corriger ces disparités. La prévention par le confinement et la qualité des soins, telles qu’elles sont mises en œuvre actuellement, représentent de bonnes réponses à la vulnérabilité. Une politique reposant sur un principe de justice sanitaire plutôt que seulement de police sanitaire dans les milieux populaires et impliquant un dépistage plus large et une prise en charge plus précoce permettrait de réduire les inégalités. Enfin, le respect de l’obligation légale d’encellulement individuel, supposant la libération de personnes détenues, notamment celles dont la présence en prison ne se justifie pas, parce que, non jugés, ils sont présumés innocents ou, condamnés à de courtes peines, ils peuvent bénéficier de mesures alternatives, peut corriger les discriminations, de même que la fermeture temporaire des centres de rétention administrative, qui ne peuvent de fait plus servir de sas en attente d’expulsions, et enfin l’hébergement convenable des personnes à la rue ou entassées dans des espaces restreints. Bien entendu, ces catégories conceptuelles et les réponses politiques qu’elles suggèrent valent aussi, en large part, pour les situations rencontrées ailleurs en Europe, et notamment pour les demandeurs d’asile et les migrants retenus dans des conditions indignes en Grèce.
La pandémie de Covid-19 a produit un fait inédit : menacée par un virus potentiellement létal, la vie est nous soudain devenue le bien le plus précieux, si précieux même qu’on a pu lui sacrifier, au moins en partie, un autre bien que beaucoup pensaient supérieur, à savoir la croissance, associée à la limitation de la dépense publique. Par un renversement de nos valeurs, la vie biologique s’est ainsi trouvée placée au-dessus de la vie économique. Health over wealth, comme le disent certains. Moment historique, à l’apogée de ce que j’ai proposé d’appeler la biolégitimité, à savoir la reconnaissance comme bien suprême du « simple fait de vivre », selon la formule de Walter Benjamin. Probablement le fait que chacune et chacun ait pu se sentir mis en danger par l’épidémie a-t-il contribué à cette évolution majeure.
Pour autant, toutes les vies ne se valent à l’évidence pas. On ne peut à cet égard pas oublier que la France se situe au troisième rang européen pour la mortalité prématurée, c’est-à-dire pour les décès survenant avant 65 ans, et tristement, occupe la première place pour la mortalité évitable, en d’autres termes pour les décès survenant avant 65 ans qu’il serait possible de prévenir. On ne doit pas non plus perdre de vue les treize années d’espérance de vie à la naissance qui séparent les 5% les plus aisés et les 5% les plus pauvres dans notre société. La célébration de la vie, que le coronavirus a induit, n’a pas la même signification pour tout le monde, et il est même probable que l’épidémie accentuera un peu plus les inégalités devant la mort qui minent notre société, non seulement du fait des conséquences de la maladie, mais aussi, et plus encore, en raison des effets de la récession économique.
Pr Didier Fassin
Chaire annuelle de santé publique (2019-2020)
Institute for Advanced Study, Princeton
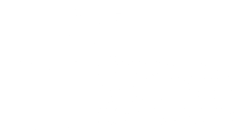
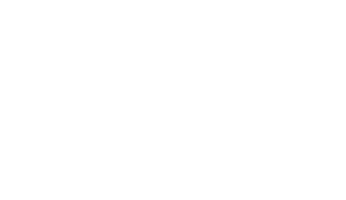










![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)
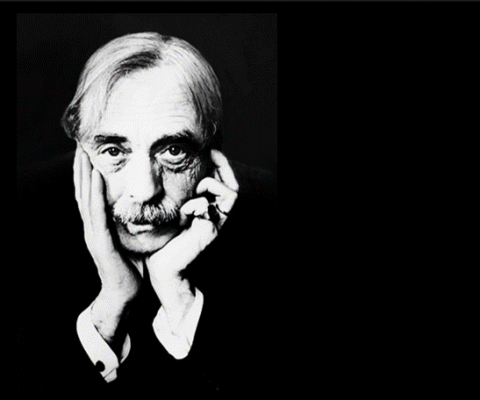


![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)



![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)




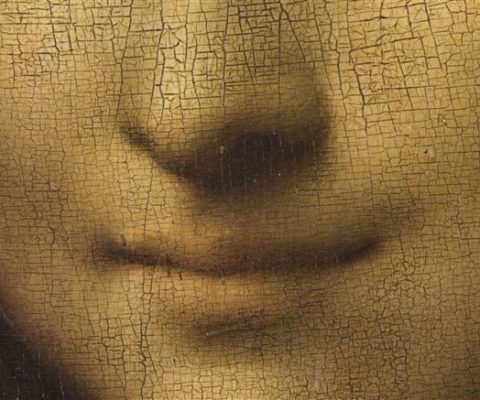

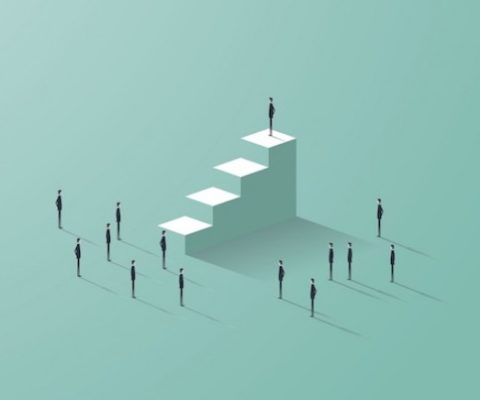

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)



![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)























![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://collegedefrance.dev7.ydu.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)